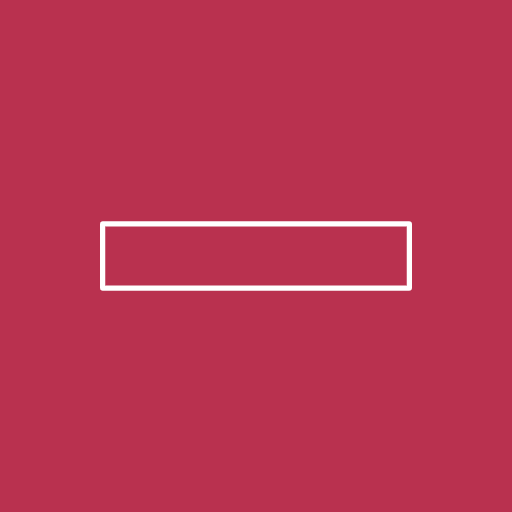Source [Valeurs actuelles] : Alors que l’accès à la pornographie n’a jamais été aussi aisé qu’aujourd’hui et fait des ravages, notamment chez les jeunes, Priscille Kulczyk, chercheur associé au Centre européen pour le droit et la Justice (ECLJ), rappelle que la France a signé il y a tout juste 100 ans la Convention internationale pour la répression de la circulation et du trafic des publications obscènes.
Alors que l’accès à la pornographie n’a jamais été aussi aisé qu’aujourd’hui et fait des ravages, notamment chez les jeunes, Priscille Kulczyk, chercheur associé au Centre européen pour le droit et la Justice (ECLJ), rappelle que la France a signé il y a tout juste 100 ans la Convention internationale pour la répression de la circulation et du trafic des publications obscènes.
Le 12 septembre 1923, plusieurs dizaines d’États, dont la France, signaient à Genève, sous l’égide de la Société des Nations, la Convention internationale pour la répression de la circulation et du trafic des publications obscènes. Par ce traité, les États se sont engagés à interdire et réprimer toute publication, commercialisation ou circulation de contenus obscènes, y compris cinématographiques. Les États parties s’engageaient donc à poursuivre et à punir le trafic pornographique, cela en des termes très larges, tant en ce qui concerne les types de contenus que les actes qui s’y rapportent.
Une initiative du gouvernement français
C’est précisément la France qui a été à l’origine de cette Convention internationale en poussant à la conclusion, dès 1910 à Paris, de l’Arrangement relatif à la répression de la circulation des publications obscènes dans le but de « faciliter (…) la communication mutuelle de renseignements en vue de la recherche et de la répression des délits relatifs aux Publications obscènes ». C’est cet accord qui a abouti, treize ans plus tard, à la Convention aujourd’hui centenaire.
Une Convention internationale à réactiver ?
Bien que tombée dans l’oubli, cette Convention internationale demeure en vigueur. En effet, la France ne l’a jamais dénoncée — et reste donc engagée —, contrairement au Danemark, aux Pays-Bas et à l’Allemagne.
Malgré cela, cette Convention est loin d’être respectée. Ainsi, la Cour de cassation a jugé en 1995 que « depuis l’entrée en vigueur de l’article 227-24 du Code pénal, la fabrication et la diffusion de messages à caractère pornographique ne sont punissables que lorsque ces messages sont susceptibles d’être vus ou perçus par un mineur ». Punissables, certes, mais malheureusement pas punis puisqu’en France, 2,3 millions de mineurs accèdent chaque mois à des sites pornographiques selon l’ARCOM. Pourtant, selon le principe de la supériorité à la loi des traités internationaux, c’est bien cette Convention internationale qui devrait prévaloir sur le code pénal qui n’a que valeur législative.